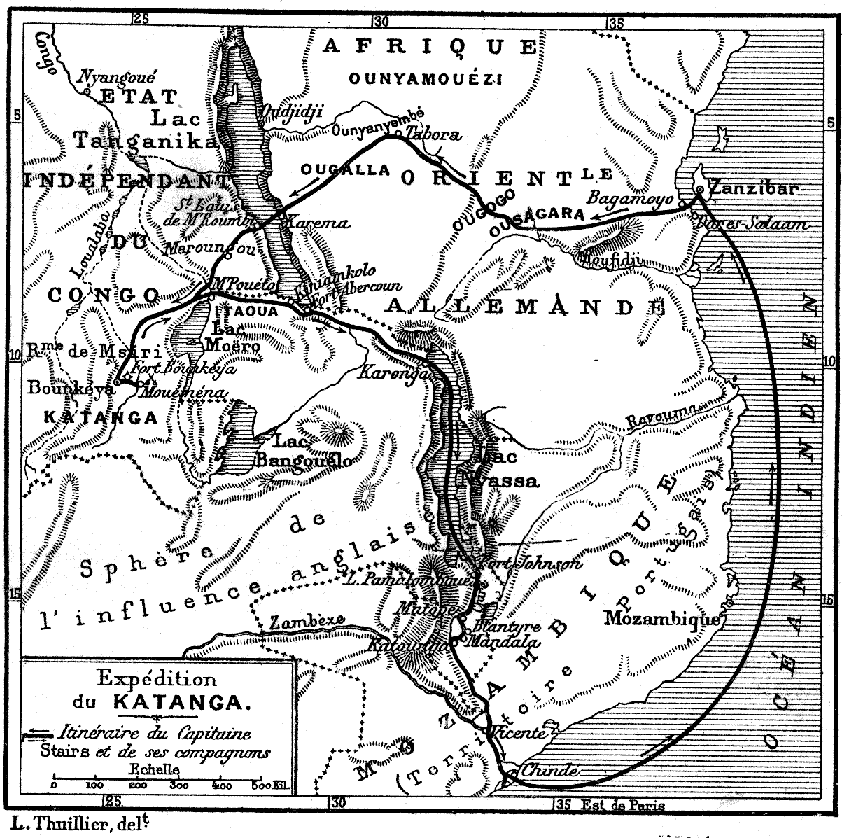
L'EXPÉDITION DU KATANGA
D'APRÈS LES NOTES DE VOYAGE DU MARQUIS CHRISTIAN DE BONCHAMPS
PAR M. RENÉ DE P0NT?JEST
I
MM Stairs, Bodson et le marquis de Bonchamps. ? De la côte orientale au lac Tanganyika. Le but à atteindre, l'influence allemande.
L’EXPÉDITION du Katanga, qui s'est terminée l'année dernière, après avoir perdu deux de ses chefs sur trois, au cours d'une excursion intéressante et dramatique de plus d'une année dans l'Afrique centrale, avait pour objectif d'occuper un territoire au sud?ouest du lac Tanganyika et à l'ouest du Moëro, et de soumettre au roi des Belges le sultan du Katanga, Msiri.
Le Royaume de Msiri, ou Katanga, situé entre les neuvième et onzième degrés de latitude sud, est borné au nord par l'État indépendant du Congo et le Kassongo, à l'ouest par les territoires portugais du Benguela, à l'est par de hautes montagnes, le lac Moëro et le Bangouéolo, et au sud par la ligne de faîte qui sépare. les eaux du Kongo de celles du Zambèze.
C'est le capitaine Stairs, de l'armée
Anglaise, l'un des compagnons de Stanley dans son dernier voyage, qui avait
été mis à la tête de cette expédition du
Katanga, dans le but de porter les frontières du Congo Belge plus près
encore des possessions Anglaises de la côte est, de façon que
l'État Indépendant eût un débouché facile
sur l'océan Indien au Mozambique, par le Zambèze, le Chiré
et le Nyassa.
La tentative était hasardeuse, pleine de périls, car le sultan
Msiri jouissait d'une détestable réputation. Seuls l'Anglais
Cameron et l'Allemand Reichart avaient tenté, mais en vain, de pénétrer
dans ses États, où il régnait par la terreur sur un peuple
sans autre religion que celle des ancêtres, avec quelques pratiques
de fétichisme; et il se montrait rebelle à toute intervention
européenne dans ses affaires. On le savait en Belgique, puisque déjà
deux tentatives n'avaient eu aucun résultat, mais Sa Majesté
Léopold n'en accueillit pas moins favorablement l'idée de cette
nouvelle expédition qui, sous le commandement de Stairs, paraissait
devoir réussir.
Stairs élan bien en effet le type de l'explorateur africain, autant au physique qu'au moral. D'une santé de fer, grand, sec, nerveux, acclimaté, infatigable, sachant se faire obéir sans violences inutiles, il connaissait le pays et, de plus, parlait couramment l'idiome du Zanzibar, le ki?souaheli, dont l'usage s'étend de la côte orientale jusqu'aux grands lacs.
Le second idiome le plus répandu dans cette partie de l'Afrique est le ki?nyamouezi. On s'en sert sur les bords du Victoria Nyanza et dans tout l'Ounyamouezi (pays de la lune), qui est sous l'influence Allemande.
Mais comme le capitaine Stairs ne pouvait songer
à partir seul, sans auxiliaires sur lesquels il pût compter,
il s'adjoignit M. Oscar Bodson, officier de carabiniers belge, et un de nos
compatriotes, le marquis Christian de Bonchamps, jeune lieutenant de notre
cavalerie territoriale, que tourmentaient, lui aussi, la fièvre de
l'inconnu et le désir de faire oeuvre utile. Avec le docteur irlandais
Moloney, et Robinson, le domestique de M. Stairs, l'expédition allait
comprendre cinq Européens, pas davantage. Les frais étaient
à la charge de la Société Belge du Katanga, fondée
tout exprès dans le but de faire du sultan Msiri un nouveau vassal
de l'État Indépendant du Congo.
Parti de Naples à la fin de mai 1891, M. de Bonchamps retrouva le 15
juin ses compagnons à Zanzibar; ils s'y partagèrent aussitôt
la travail d'organisation, et pendant que M. Stairs restait dans l'île,
MM. de Bonchamps et Bodson allèrent recruter sur la côte, à
Bagamoyo et à Dar?es? Salaam, les hommes nécessaires.
Moins de quinze jours suffirent aux explorateurs pour être prêts. Leur caravane se composait de 360 indigènes, dont 300 porteurs chargés, ainsi qu'une demi?douzaine de petits ânes de Mascate, des objets d'échange, des tentes, des provisions et des munitions. Les soixante autres engagés, triés sur le volet, sans fardeaux et bien armés d'excellents fusils système Gras, formaient l'escorte.
Avant de quitter Bagamoyo, c'est?à?dire la côte, MM. Stairs, de Bonchamps et Bodson se partagèrent les rôles. Chacun d'eux prit le commandement d'une compagnie de cent vingt hommes. Le docteur Moloney était chargé, indépendamment du service médical, de la marche des embarcations, car l'expédition emportait deux canots démontés, en tôle d'acier.
Ces dispositions prises, la caravane partit le 4 Juillet 1891, pour s'engager dans l'Ousagara, pays riche, bien cultivé, entrecoupé de bois et de prairies, et qui est sous l'influence allemande. Bien que la route n'existât que sous la forme d'un sentier d'un mètre de largeur à peu près, la marche y était facile; les Européens n'y rencontrèrent que de rares indigènes. Terrorisées par les Allemands, les tribus paisibles qui occupent cette contrée s'étaient réfugiées dans les bois, où elles avaient construit de nouveaux villages.
Ces villages sont toujours et partout les mêmes une centaine de huttes en claies et en argile, surmontées d'un toit conique, fait de roseaux et de chaume. Un borna, haute palissade protégée par un talus et un fossé, les entoure. Leurs défenseurs sont armés de flèches, de lances et de quelques fusils de pacotille.
La troupe s'était mise en route en pleine saison sèche, qui règne de mai à novembre. Le climat était sain, mais la chaleur accablante et l'eau potable fort rare, les rivières étant desséchées et les puits, qui n'existent que dans les villages, ne contenant presque toujours qu'un liquide répugnant.
Les voyageurs atteignirent néanmoins sans péril ni grande fatigue le désert d'argile rouge de l'Ougogo, pays sans eau et où s'élèvent quelques rares palmiers sans fruits. Il leur fallut dix jours pour le traverser, et le 15 septembre ils arrivèrent à Tabora, capitale de l'Ounyanyembe (Le pays des houes).
Tabora est une agglomération de villages dont la population, en partie arabe, s'élève à 20 000 âmes, et qui s'étendent dans une plaine bien cultivée et entourée de monticules boisés.
Là encore s'exerce l'influence des Allemands, qui, après les échecs répétés que leur ont fait subir les Ouahehe et les Ouamoehi, n'ont trouvé d'autre moyen d'assurer la tranquillité de leur territoire que de nommer à Oudjidji, sur le Tanganyika, un gouverneur de race arabe, un certain Roumalieza, bien connu comme un des plus grands esclavagistes de l'Afrique centrale.
C'est cet homme qui paraît être le chef du soulèvement contre les Européens.
De Tabora, où ils se reposèrent quatre jours, renouvelèrent leurs provisions et augmentèrent leur caravane de quarante hommes, M. Stairs et ses compagnons reprirent leur route à l'ouest, à travers les riches contrées de l'Ougalla, pays giboyeux et fertile, qui s'élève en plateaux boisés jusqu'au Tanganyika, dont ils aperçurent les rives le 15 Octobre, en arrivant à Karéma.
Cent jours s'étaient écoulés depuis que la caravane avait quitté la côte de Zanzibar; elle n'avait pas perdu un seul porteur, et sauf quelques escarmouches avec des pillards à sa sortie de l'Ougogo, son voyage s'était bien passé. L'état des engagés était excellent, au moral et au physique.
II
Le lac Tanganyika. ? Karéma. ? Les stations anti esclavagistes. ? Les Pères Blancs d'Alger. ? Le capitaine Joubert. ? A travers le Maroungou. ? Le Louapoula. ? Les sources du Congo ? Bunkéia, la capitale de Msiri.
Karéma est l'une des plus importantes stations des Pères Blancs d'Alger dans l'Afrique centrale. Ils y ont groupé autour d'eux une population nombreuse.
C'est en face de Karéma, de l'autre côté du Tanganyika, que se trouve Saint?Louis de Roumbi, le poste anti esclavagiste fondé il y a trois ans par le capitaine Joubert, un ancien zouave pontifical, qui vit là au milieu de quelques indigènes, tout à son œuvre humanitaire. Dès qu'il connut l'arrivée de M. Stairs, M. Joubert lui offrit de joindre son concours à celui des Pères Blancs pour le transport de sa caravane sur la rive ouest du lac, traversée qui se fait à la voile et à l'aviron, sur des canots creusés dans des troncs d'arbres de plus de 20 mètres de long, exige au moins trente?six heures et ne s'exécute pas toujours sans accidents.
Entouré de montagnes que séparent de profondes vallées, semé de récifs, tourmenté par des courants rapides, exposé à des rafales fréquentes et peuplé de crocodiles, le Tanganyika est souvent dangereux.
Le marquis de Bonchamps partit le premier, pour établir un camp à proximité de Saint?Louis de Roumbi, mais il ne put mettre pied à terre qu'après avoir repoussé les indigènes armés de fusils, qui voulaient s'opposer à son débarquement. Un de ses canots fut attaqué par un hippopotame et faillit sombrer. Les hommes furent sauvés, mais les ânes périrent des suites de cette pénible traversée.
Cependant, malgré ce début de
mauvais augure, il suffit de douze jours à la caravane pour se retrouver
tout entière sur la rive occidentale du lac, et le 31 Octobre elle
descendit au sud?ouest, dans le Maroungou, pays montagneux, boisé et
coupé de marécages.
Quelques pluies, soir et matin, annonçaient le prochain changement
de saison, mais les chaleurs restaient accablantes et la marche devenait difficile,
à travers taillis et marais, où le gros gibier abondait.
Les explorateurs rencontraient bien çà et là quelques villages misérables, dont les habitants, armés de mauvais fusils de provenance anglaise, de lances et de flèches empoisonnées, ne s'opposaient pas à leur passage, mais plus de missions, plus d'Européens, et ils devaient se frayer un sentier à travers la brousse, faisant à peine quelques lieues par jour et ayant à se défendre, la nuit, non contre les fauves, que les grands feux tenaient à distance, ni contre les reptiles, qui sont fort rares, mais contre les insectes, les scorpions, les centripètes et une horrible chenille, dont le seul contact donne de violents accès de fièvre.
Malgré tous les obstacles et toutes
les fatigues, quinze jours suffirent à l'expédition pour atteindre
les rives du Louapoula, c'est?à?dire la branche maîtresse du
Congo. C'était à cette époque la limite sud?est de l'influence
belge. Le chef de la contrée, N'Gouena,
fit un excellent accueil à M. Stairs, mais il lui affirma que Msiri
était un tyran cruel et puissant, de qui il n'aurait pas raison plus
aisément que ses prédécesseurs dans le Katanga. Tous
avaient dû revenir sur leurs pas.
Ces renseignements, qui ne faisaient que confirmer la triste réputation de Msiri, ne pouvaient arrêter un instant les hardis voyageurs. Ils se hâtèrent au contraire de traverser le Louapoula, qui, là où ils se trouvaient, n'a pas moins de 500 mètres de largeur et est semé d'îles d'une luxuriante végétation. Malheureusement son courant est extrêmement rapide et de nombreux récifs en rendent la navigation dangereuse, même impossible, en nombreux endroits de son parcours.
Néanmoins, grâce à ses canots et à l'aide de N'Gouena, le capitaine Stairs put transporter en deux jours tout son monde sur la rive opposée de la rivière. Le but de l'expédition était atteint en partie: après cent vingt jours de marche, elle pénétrait enfin dans le Katanga, mais le plus facile seulement était fait. Ses chefs en eurent immédiatement la preuve. Tenus par leur cruel souverain dans un éternel état de terreur, les indigènes fuyaient devant eux, leur refusaient des guides et des vivres, faisaient le vide, et la caravane, épuisée, toujours sur le qui?vive, mit tout un mois avant d'arriver, le 14 décembre, en vue de l'enceinte de Bunkéia, la capitale du fameux Msiri, à qui M. Stairs avait envoyé les compliments et les cadeaux d'usage pour se le rendre favorable.
II ne s'agissait plus que de parvenir jusqu'au sultan noir. Celui?ci fit bien savoir au capitaine qu'il avait reçu ses présents, et lui adressa un de ses officiers pour le conduire à l'endroit où il devait établir son camp, mais, imposant aux étrangers une sorte d'étiquette, il remit à trois jours l'audience qu'il leur accordait.
Le point désigné par les ordres du sultan pour l'installation de la caravane était à quelques centaines de mètres du quikoro (demeure royale), entouré de villages populeux. Les explorateurs allaient ainsi se trouver cernés de toutes parts, mais l'officier anglais n'en prit pas souci et, tambours battant, drapeau du Congo déployé (bleu avec une étoile d'or au centre), il vint prendre possession du terrain momentanément concédé. Puis, sans perdre un instant, il établit son campement de façon à y être à l'abri de toute surprise, car ce qu'il voyait de Bunkéia lui commandait la plus extrême prudence.
En effet, sur bon nombre des pieux élevés qui formaient l'enceinte de la ville, agglomération de plusieurs villages dans une plaine immense arrosée par la rivière Unkéia, affluent de la Lufna, on apercevait des têtes humaines, les unes desséchées, trophées de quelques vieilles razzias, les autres toutes fraîches, sanglantes, datant de la veille à peine, exhibées peut?être dans le seul but de prouver aux arrivants la justice expéditive et la puissance du roi nègre.
De plus, le capitaine Stairs savait que l'expédition belge commandée par M. Le Marinel et venue par le Congo avait dû se retirer vers le nord, en ne laissant du côté de la Loualaba, à la station de la Loufna, affluent de la Loufira, que son représentant M. Legat, et qu'une seconde expédition, dirigée par M. Delcommune, était dans le pays. Seulement on ignorait dans quelle direction. Msiri, il est vrai, avait remis une lettre de soumission à M. Le Marinel, mais il allait bientôt la désavouer publiquement, devant M. Stairs lui?même, et il n'avait jamais accepté le pavillon du Congo.
D'ailleurs ces lettres de soumission de ces petits tyrans africains, auxquels on lit quatre longues pages, dont, le plus souvent, ils ne comprennent pas un mot, et qu'ils approuvent d'une croix, afin d'avoir la, paix et des présents, ne sont sérieuses que pour les puissances européennes, en cas de contestations de territoires. Quant au souverain noir qui les signe, il ne s'en inquiète pas un seul instant.
Msiri avait donc promis à M. Stairs de le recevoir dans trois jours, mais il faisait la sourde oreille à ses demandes de vivres, et la caravane manquait de tout, ainsi d'ailleurs que trois missionnaires anglais, de la secte des Amis, campés i également sous les murs de Bunkéia et véritables prisonniers, depuis le départ de leur chef, le Révérend Arnot, pour l'Europe. Ces missionnaires s'étaient établis depuis quelque temps dans les Etats de Msiri, mais ils n'avaient pu le faire renoncer à ses coutumes barbares. Les malheureux prédicants avaient beau lui adresser des cadeaux, il re fusait de les laisser partir, sous le prétexte que le pays n'était pas tranquille. Il ne voulait pas qu'on le rendît responsable de leur mort. Ils devaient patienter jusqu'à ce qu'il jugeât le moment favorable.
La vérité, c'est que le rusé despote savait que les Anglais devaient recevoir de nombreux ballots de la côte et qu'il comptait bien soit les piller, soit leur faire payer fort cher son autorisation de se mettre en route. En attendant, à toute heure du jour et de la nuit, il les envoyait chercher, puis, quand ils arrivaient au quikoro, il leur faisait dire qu'il n'avait pas le temps de les recevoir. M. Arnot avait bien offert, lui aussi, le pavillon de sa nation à Msiri, mais sans plus de succès que M. Le Marine). Le Roi du Katanga acceptait tout des étrangers, sauf leurs, drapeaux.
La situation se dessinait donc peu favorablement, et M. Stairs mettait toute son activité à fortifier son camp, lorsque, le 17 décembre au matin, Msiri lui fit savoir qu'il le recevrait dans l’après-midi.
Informés de cette audience, les missionnaires supplièrent leur compatriote d'intercéder pour eux auprès de leur geôlier. M. Stairs le leur promit, et, vers trois heures, accompagné de M. Bodson et de douze hommes, il franchit l'enceinte de Bunkéia, où, par procédé d'intimidation ou simplement en forme de bienvenue, on avait renouvelé les exhibitions de têtes coupées.
III
Le sultan Msiri. ? Son sérail. Étrange lait Mamilla. ? Duplicité de rai. ? Ultimatum du capitaine Stères. ? Fuite (le Msiri. ? Assassinat (le M. Bodson. ? Prise de Moémena par le marquis de Bonchamps. ? Mort de Msiri.
Après avoir suivi un dédale de ruelles, formées de cases bien entretenues, ombragées par des palmiers et entourées de bosquets d'euphorbes, MM. Stairs et Bodson atteignirent une vaste place, où s'élevait le quikoro, grande case précédée d'une véranda, d'une construction fort primitive et couverte en chaume.
Le roi était assis là dans un fauteuil européen, cadeau d'un traitant de la côte occidentale, du Benguéla, où l'on peut se rendre facilement par les hauts plateaux. C'est la route que fréquentaient jadis les négriers portugais. Bon nombre d'explorateurs, Cameron entre autres, l'ont prise. Malgré les marais, les fauves et les tribus insoumises de l'intérieur, c'est, en réalité, après la routé du Nyassa vers l'est, le chemin le plus court et le meilleur pour pénétrer dans l'Afrique centrale.
Msiri avait une soixantaine d'années. Il était de haute taille, robuste, avec une physionomie sournoise et rusée. Enveloppé dans une grande robe d'étoffe jaunâtre, comme en portent les Orientaux de la côte est, il était coiffé d'un turban rouge et avait aux jambes et aux bras de lourds anneaux d'ivoire et de cuivre. Un long collier d'ivoire faisait le tour de son cou et retombait sur sa poitrine. A sa droite se tenaient, accroupis, son secrétaire interprète, un Souaheli de la côte orientale, qui parlait et écrivait l'arabe, et un bouffon, horrible nain, tout?puissant auprès de son maître.
En arrière du sultan étaient, à demi couchées sur des nattes, ses. quarante femmes, surchargées de bijoux de cuivre et d'ivoire, vêtues de pagnes aux couleurs éclatantes, et les cheveux divisés en tresses ornées de coquillages. Toutes ces femmes étaient jeunes et quelques?unes vraiment jolies, surtout trois métisses portugaises de quinze ans à peine, que leur teint moins foncé et leurs formes plus élégantes faisaient ressortir au milieu des épouses de Msiri.
Il était en relation avec les comptoirs portugais de la côte occidentale; et c'est de là qu'il recevait des femmes, des armes et des munitions.
Quelques?unes de ces favorites devaient l'ampleur et la fermeté de leur poitrine à un moyen bizarre, mais que le pays seul peut fournir. Quand une coquette de là?bas veut remédier au manque de générosité de la nature envers elle à ce sujet, elle se fait piquer les seins par certaines fourmis rouges, dont la morsure, presque invisible, a la propriété de gonfler et, par conséquent, d'affermir les chairs.
Enfin, debout devant leurs cases, qui formaient les trois autres côtés de la place, cent cinquante guerriers, armés les uns de lances et les autres de flèches et de fusils, représentaient la garde du quikoro.
Quand les deux étrangers furent arrivés devant lui, Msiri répondit à leur salut en se soulevant légèrement de son fauteuil, la main sur la poignée du sabre dont ils lui avaient fait présent trois jours auparavant, et l'audience commença avec le concours de l'interprète, car le roi ne parlait que quelques mots d'arabe et le kinyamouezi, que Stairs comprenait à peine.
Le capitaine Stairs expliqua d'abord au sultan le but de sa mission elle était toute pacifique; il venait lui offrir de signer un traité d'alliance avec le souverain blanc du Congo, traité, en échange duquel il recevrait de nouveaux présents et aurait l'aide des Européens contre ses ennemis. Ensuite, pour tenir la promesse qu'il avait faite à ses compatriotes, il lui demanda de laisser partir les missionnaires.
Msiri se fit répéter à plusieurs reprises toutes ces propositions, comme s'il voulait les bien comprendre; puis, au bout d'une heure, il congédia M. Stairs, presque gracieusement, mais sans lui avoir rien offert, pas même un verre d'eau. Il lui promettait seulement de réfléchir et l'invitait à revenir le lendemain.
Le jour suivant, en effet, l'officier Anglais retourna au quikoro, mais seul, et le roi lui fit aussitôt de vives protestations d'amitié. M. Stairs lui renouvela alors sa requête en faveur des missionnaires, qui, craignant d'être massacrés et comptant peu sur leur escorte de quelques indigènes des plateaux de Bihé, avaient envoyé un émissaire au poste belge de M. Legat, pour lui demander protection. Et comme le souverain du Katanga ne répondait que d'une façon ambiguë, le capitaine lui dit: «Tu affirmes que tu es mon ami et tu me refuses des vivres! Tu sais cependant que mes hommes ont faim. Si demain tu ne me donnes pas une réponse favorable, si tu n'envoies pas à mon camp ce dont j'ai besoin? tu sais d'ailleurs que je te payerai tout généreusement ? je ne croirai pas à ton amitié; tandis que je suis prêt à te prouver la mienne, en faisant flouer au?dessus de ta ville mon drapeau, qui te protégera contre tes ennemis».
Le pays était alors divisé entre les Ouassengas, premiers propriétaires du sol, et les Ouassembuas, partisans du sultan. Les Ouassengas reprochaient à Msiri d'ordonner à chaque instant des razzias dans leurs villages, pour s'emparer de l'ivoire et des femmes, et aussi de maltraiter leurs Chefs lorsque ceux?ci venaient se plaindre. Le plus souvent, il est vrai, le tyran noir faisait décapiter ou dévorer par des chiens les ambassadeurs de ses adversaires, ou, s'il les renvoyait, c'était après leur avoir fait couper les oreilles.
Au moment même où la nouvelle mission belge était arrivée à Bunkéia, Loukoukou, le Grand Chef militaire du Roi, se trouvait dans le sud?est, où, à la tête de 5 000 hommes, il luttait contre les Ouassengas en pleine révolte. C'est cette absence seule qui imposait à Msiri son attitude relativement bienveillante à l'égard des étrangers. Il attendait tout simplement le retour de ses guerriers pour lever le masque. Aussi ne répondit?il pas plus franchement encore cette fois à M. Stairs, qui retourna auprès de ses compagnons pour étudier avec eux la situation et les moyens d'en sortir, car évidemment elle devenait dangereuse.
Le soir même, les explorateurs en eurent la preuve par la communication que l'interprète du sultan vint leur faire : son maître ne pouvait pas traiter avec eux, parce qu'ils étaient les amis d'un homme méchant, M. Legat? M. Legat s'était tout simplement éloigné en refusant de se soumettre aux caprices du roi, dont les audiences se succédaient sans résultat, ?mais comme il voulait donner aux blancs une preuve de ses bonnes dispositions et de sa gracieuseté, il autorisait les missionnaires à partir le lendemain. De plus, il permettait à la caravane d'aller s'installer à deux journées de marche de Bunkéia, dans une plaine arrosée par un grand cours d'eau, où le gibier abondait et où elle ne manquerait de rien.
C'était là un piège. Msiri voulait séparer les Anglais de l'expédition Belge, de façon à avoir plus facilement raison des deux caravanes. M. Stairs le comprit, et, tout en acceptant l'offre du sultan à propos des missionnaires, qui firent aussitôt leurs préparatifs de départ, il refusa, quant à lui, de changer d'emplacement, du moins pour l'instant, et, de retour au camp, il demanda à ses compagnons quel était leur avis.
MM. de Bonchamps et Bodson avaient la même manière de voir. Il fallait absolument en finir en posant un ultimatum à Msiri, car ils. ne pouvaient songer en aucun cas à quitter un pays où ils avaient pénétré au prix de si grandes fatigues. L'expédition devait retourner à la côte avec un résultat, quel qu'il fût.
M. de Bonchamps proposa même de brusquer les choses à l'aide d'un coup de main aussi hardi qu'ingénieux. Il avait appris, d'un des sujets du roi, que celui?ci sortait la nuit de Bunkéia, pour se rendre à 800 mètres de sa résidence, dans le village où habitait sa favorite Maria da Fonseca, l'une de ses belles métisses portugaises. Il ne se faisait accompagner que de quelques guerriers. Rien ne serait plus facile que de s'emparer de lui. On le garderait en otage.
Le projet était tentant, mais M. Stairs le combattit. Il craignait que cet enlèvement ne provoquât un soulèvement général, dont les missionnaires anglais, qui ne s'étaient mis en route que le matin, seraient les premières victimes, et l'on renvoya au jour suivant pour prendre une décision.
Mais le lendemain, de fort bonne heure, l'interprète
de Msiri vint annoncer aux étrangers que son maître les recevrait
dans l'après?midi.
L'interprète était accompagné d'une demi?douzaine d'individus,
porteurs du tambour national, grand cylindre de bois à l'extrémité
supérieure duquel est tendue une peau écailleuse de tatou, parfois
de serpent, et pendant qu'il s'entretenait avec MM. Stairs et de Bonchamps,
les sujets de Msiri allaient et venaient, examinant tout autour d'eux et exécutant
sur leurs instruments une foule de roulements, qui se succédaient à
intervalles distincts, sans jamais se ressembler. A l'aide d'une langue des
sons à laquelle les peuples civilisés n'ont pas encore songé,
ils indiquaient tout simplement ainsi à leur chef, qui en prenait note,
les forces du camp, ses dispositions de défense, tout ce qui était
de nature à l'intéresser. Si familiarisé qu'il fût
avec les mœurs africaines, l'officier anglais ignorait encore ce curieux
moyen d'espionnage.
M. Stairs répondit an secrétaire qu'il se rendrait auprès de son maître à l'heure indiquée; mais, avant de partir, il résolut, d'accord avec ses compagnons et M. Legat, qui, de la Loualaba, était descendu jusqu'au camp, que cette visite au sultan serait la dernière. Il savait qu'une expédition anglaise qui se dirigeait vers Bunkéia ne pouvait tarder à arriver, et il était indispensable que Msiri eût accepté le pavillon du Congo avant qu'elle parût, car cette expédition ne manquerait pas de profiter du désaccord des Belges avec le roi pour lui offrir le drapeau anglais. D'un autre côté, le retour de l'armée de Loukoukou était imminent. Il fallait donc en finir le jour même, 19 décembre.
Ce parti résolument arrêté,
le capitaine se dirigea à deux heures vers la demeure royale. M. de
Bonchamps l'accompagnait, et leur escorte se composait de trente hommes bien
armés. M. Bodson et le docteur Monoley restaient au camp, prêts
à toute éventualité.
Laissons ici la parole à notre compatriote.
«Nous trouvâmes Msiri presque seul,
raconte le marquis de Bonchamps; cinq ou six guerriers à peine se tenaient
près de lui. Une fois les compliments d'usage échangés,
nous lui dîmes que puisqu'il se prétendait notre ami, il ne devait
pas hésiter plus longtemps à nous en donner la preuve en acceptant
notre protection, symbolisée par le pavillon de l'État Indépendant;
mais il répondit aussitôt, avec orgueil
«? Je n'ai pas besoin d'être protégé; je suis le
plus grand roi de l'Afrique centrale. On me calomnie en m'appelant despote.
Je règne selon les usages de mon pays et je sais faire rentrer dans
le devoir ceux qui tentent de se soulever contre moi.
«? Soit, reprit M. Stairs, soit, tu es
un grand roi, mais d'autres, plus puissants que toi encore, qui avaient refusé
l'appui des Européens, ont été anéantis si complètement
qu'on a même oublié leurs noms. Ta conduite avec nous n'est pas
celle du souverain que tu prétends être. Quand un chef reçoit
en ami un autre chef, il ne laisse pas ses serviteurs mourir de faim. Tu dis
que tu gouvernes pacifiquement ton pays? Cependant, depuis huit jours, nous
n'avons traversé que dés contrées dévastées,
rencontré que des populations terrorisées, et même ici,
autour de toi, de hideuses dépouilles attestent que tu n'es pas un
homme, mais un fauve. Si tu veux me prouver mon erreur et ta sincérité,
tu n'as qu'à m'envoyer des vivres, à accepter mon drapeau et
à signer un pacte avec moi
«A cet ultimatum Msîri eut un sourire qui exprimait assez le plaisir
qu'il aurait pris à faire tomber nos têtes, s'il l'eût
osé, puis il finit par dire
«? J'accepte ton drapeau, va le chercher!»
«Avant de quitter le camp nous nous étions munis de plusieurs
drapeaux de l'Etat indépendant; nous nous empressâmes de les
déployer, mais, sans attendre que nous les lui eussions offerts, Msiri
s'écria:
«? Non, je ne veux pas de ce drapeau?là, il ne vaut rien! C'est
le même qu'un méchant homme, ton compatriote, M. Legat, voulait
m'imposer.
«? M. Legat ne t'a rien imposé, riposta Stairs, puisque tu avais
signé une lettre par laquelle tu faisais ta soumission à mon
grand sultan Léopold.
«? C'est faux ! Je ne connais pas cet
homme qui prétend avoir obtenu de moi une pareille chose C'est un menteur
! Je sais que son chef (M. Le Marinel) lui a envoyé des présents
qui m'étaient destinés, mais il les a gardés pour lui».
«Toutes les marchandises et les munitions avaient été
détruites par une explosion de poudre.
«Nous insistâmes encore cependant, et Msiri, après de longues
indécisions, se décidant enfin:
«? Je veux bien votre drapeau, dit?il, mais ceux que vous m'offrez sont
trop petits. Apportez?m'en demain un plus grand, et l'un de mes fils fera
l'échange de sang avec l'un de vous».
«Et comme j'avais fait signe que j'étais
prêt à passer par cette cérémonie barbare, commune
à bon nombre de peuplades africaines, et qui consiste à mêler
dans le même vase quelques gouttes de sang de ceux qui scellent ainsi
leur amitié, Stairs répondit :
«? Mon chef fera l'échange du sang avec ton fils. A demain! Quant
à un drapeau, je n'en ai pas de plus grand.
«? Eh bien, j'accepte!»
«Et, nous congédiant d'un geste de mauvaise humeur, il disparut
dans son habitation, sans paraître se préoccuper ni même
entendre l'adieu que nous lui adressions à haute voix, en ces termes:
«? Puisque tu ne prends pas de bonne grâce le pavillon du Congo,
nous allons te l'imposer de force!»
«En effet, nous courûmes aux palissades, gagnâmes la colline
de 300 pieds environ de hauteur, qui domine Bunkéia à l'ouest,
et bientôt le drapeau du Congo Indépendant flottait sur le territoire
de Msiri, sans que, d'ailleurs, les habitants du village eussent protesté
contre cette prise de possession.
«Cela fait, nous reprîmes tranquillement le chemin du camp, et nous allions l'atteindre, lorsque nous fûmes rejoints par le secrétaire du roi. Il avait couru après nous pour nous affirmer qu'il blâmait son maître et nous promettre de tout tenter pour le ramener à de meilleures dispositions. Nous ne lui répondîmes, sachant bien ce que valaient ses protestations, qu'en l'emmenant comme otage, et nous fîmes aussitôt nos préparatifs de défense. Nous nous attendions à être attaqués à chaque instant.
«Pendant la nuit du 19 au 20, tout le monde devait veiller, et le calme n'avait pas été troublé, lorsque, à deux heures du matin, quelques indigènes sans armes vinrent nous apprendre que Msiri avait quitté Bunkéia avec ses femmes et ses richesses, composées d'ivoire, de cuivre et même d'un peu d'or. C'était là un fait grave, mais nous pouvions d'autant moins songer à nous mettre immédiatement à la poursuite du fugitif que nous ignorions la direction qu'il avait prise. Nous attendîmes le point du jour, et le 20 décembre, à cinq heures du matin, nous détachâmes quelques?uns de nos plus sûrs nyamparas (sous?officiers indigènes) vers la demeure royale, pour se renseigner exactement. Peu d'instants après, ils revinrent nous dire que le sultan était parti pour Moémena, grand village à quelques milles dans le sud?est.
«Cette fuite était une sorte de déclaration de guerre, nous ne pouvions en douter. Nous résolûmes alors de lever notre camp pour mettre en sûreté nos marchandises et nos munitions dans un endroit plus facile à défendre, et nous choisîmes le village fortifié qu'habitait, la veille encore, la métisse Maria de Fonseca.
«Moins de trois heures après, notre installation nouvelle était achevée; nous étions en état de repousser toute attaque, et Stairs, complètement rassuré, nous fit appeler, Bodson et moi, vers neuf heures pour nous envoyer à Msiri, auprès de qui il voulait faire une dernière tentative de conciliation. Nous prîmes chacun cinquante hommes bien armés et nous nous dirigeâmes vers Moémena, où nous arrivâmes à 1heure.
«Le Roi avait bien choisi son refuge.
Moémena était un grand village fortifié, un borna de
plus de 1000 mètres de long, défendu par une solide palissade,
un talus et un fossé, que dissimulaient d'épais buissons d'euphorbes.
Il était adossé au sud à une colline difficile à
escalader, et une immense plaine marécageuse le protégeait au
nord. Sa population devait être nombreuse, mais tout y était
calme. C'est seulement lorsque nous fûmes arrivés à une
centaine de mètres du village, que nous en vîmes sortir un individu
armé d'un fusil, ainsi que les deux guerriers qui l'accompagnaient.
Sans trop d'hésitation, ce chef vint à nous et demanda ce que
nous voulions
«? Parler à ton roi, lui répondis?je. Nous savons qu'il
est dans le village. Tu peux l'assurer que nous n'avons que des intentions
pacifiques.
«? Alors, donne?moi quelques?uns de tes soldats et j'irai avec eux prier Msiri de vous recevoir».
«J'ordonnai aussitôt à un de mes sous?officiers et à quatre hommes de suivre l'envoyé du sultan. Peu d'instants après, la petite troupe disparaissait derrière les palissades du boma.
«Vingt minutes s'écoulèrent, nos soldats ne revenaient pas, et, de plus, nous apercevions par moments, à travers les buissons d'euphorbes, des guerriers qui semblaient nous surveiller. L'inquiétude alors s'empara de nous: nos envoyés avaient dû être massacrés; il ne nous restait plus qu'à pénétrer dans le village pour les venger et avoir raison de la félonie de Msiri. Déjà j'avais réuni mon détachement, lorsque Bodson me dit qu'il croyait préférable d'aller d'abord trouver le roi, qui n'oserait certainement rien contre lui. Je m'efforçai de le dissuader de cette démarche. Le retard que nos gens mettaient à revenir pouvait être un guet?apens; il valait mieux engager la lutte ensemble, plutôt que de nous désunir. Le courageux officier tint bon; il partit avec une douzaine d'engagés. Il était convenu que, s'il se trouvait en danger, il m'en avertirait en déchargeant son revolver.
«C'est avec un violent serrement de cœur que je suivis Bodson du regard jusqu'à ce qu'il eût disparu. C'était un ami dont j'avais eu, depuis six mois, de fréquentes occasions d'apprécier les solides qualités. Je me préparai donc à voler à son secours, en plaçant mes hommes en front de bataille, à 4 ou 5 mètres les uns des autres, armes chargées, mais avec ordre de ne tirer qu'à mon signal. Ces dispositions étaient prises depuis dix minutes à peine, lorsque j'entendis tout à coup, partant du centre du village, plusieurs coups de revolver, aussitôt suivis d'une fusillade. Au même instant, plusieurs balles sifflèrent à mes oreilles.
«Les indigènes n'attendaient pas mon attaque, ils tiraient les premiers, et mes hommes en avaient éprouvé une telle surprise qu'ils avaient, eux aussi, déchargé leurs armes, un peu au hasard. Mais cette sorte de panique ne dura qu'une seconde. A ma voix, ils s'élancèrent et nous franchîmes les palissades, où nous accueillirent tout d'abord les coups de feu des soldats de Bodson, qui nous prenaient pour des ennemis.
«D'un autre côté, cachés au milieu des massifs d'euphorbes, les défenseurs de Msiri nous fusillaient de leur mieux. Je n'en hâtai que plus rapidement ma marche en avant, anxieux que j'étais de retrouver mon ami, quand j'aperçus une troupe d'individus, vêtus de pagnes blancs, qui fuyaient. dans la direction du marais. Pensant que ces fugitifs emmenaient le sultan, j'ordonnai à vingt de mes soldats de les rejoindre.
«A ce moment, un des engagés qui
avaient accompagné Bodson vint m'annoncer que le roi était,
au contraire, au centre du village et se défendait. Je ralliai rapidement
tous mes combattants, et, dirigé par les crépitements mêmes
de la fusillade, j'arrivai bientôt sur une grande place jonchée
de cadavres, et où, sur le seuil de la barza d'un grand tembé,
Bodson gisait inanimé, auprès du corps de Msiri.
«A quelques pas de là, un des fils du sultan râlait, mortellement
frappé, et deux de nos soldats gémissaient, les jambes traversées
par des balles.
«A mon apparition, les indigènes s'étaient enfuis à travers les haies. Je courus à mon compagnon et le fis porter sous la barza, où il reprit connaissance. Là, malgré l'horrible blessure qu'il avait reçue, il voulut me raconter ce qui s'était passé.
«En arrivant auprès de Msiri, il l'avait trouvé entouré de trois cents guerriers, et, comme pour répondre à sa question relative au but de sa visite, il lui avait reproché sa mauvaise foi et sa fuite de Bunkéia, en ajoutant qu'il voulait l'emmener à notre camp pour palabrer avec le capitaine Stairs, le sultan, furieux, l’œil injecté, s'était élancé sur lui pour le frapper de ce sabre même dont nous lui avions fait cadeau. Bodson, alors, mis en cas de légitime défense, n'avait eu que le temps, pour ne pas être tué, de tirer sur son assaillant, qu'il avait abattu de trois coups de revolver. Mais il avait aussitôt reçu lui?même, au côté droit, un coup de feu, et il était tombé à terre.
« Pendant que j'étais ainsi auprès de mon ami, faisant de mon mieux pour le soulager, le combat était devenu général. Démoralisés par la mort de leur Roi et ne sachant pas le nombre des ennemis qu'ils avaient à combattre, les sujets de Msiri fuyaient à travers le village, tout en se défendant à coups de fusil, et mes soldats, obéissant à leur nature, se livraient à un pillage effréné. J'aurais voulu m'y opposer, mais je ne pouvais m'éloigner de Bodson. On l'eût aussitôt achevé. Cependant il était nécessaire que je rassemblasse mes hommes, contre lesquels les indigènes allaient peut?être faire quelque retour offensif.
«Je montai alors sur le toit du tembé, afin de me rendre moi?même compte des choses, et aussi pour tenter de faire de là des signaux au camp; mais à peine eus?je atteint la plate?forme de chaume, que je devins le point de mire d'une véritable fusillade. Je sautai bien vite à terre, où je recommençai à crier si fort que je finis enfin par réunir une quarantaine de mes engagés. Je les mis en sentinelles autour de la place, et j'expédiai un de mes sous?officiers à Stairs, pour l'informer de ma situation et lui dire de m'envoyer Moloney, avec un brancard et des munitions, car les miennes étaient à peu près épuisées.
«Ces ordres donnés et ces dispositions
prises, je revins à mon pauvre ami, dont l'état s'aggravait,
et j'attendais ainsi depuis une heure, m'efforçant de donner au blessé
un espoir que je n'avais pas, lorsque j'entendis des coups de feu dans le
nord de Moémena.
«C'était le docteur Moloney.
«Bientôt il me rejoignit et, tout d'abord, s'occupa de Bodson. Une balle lui avait traversé les intestins et était allée se loger dans la colonne vertébrale. Nous étendîmes doucement le malheureux dans un hamac et reprîmes le chemin du camp, en emmenant quelques prisonniers, hommes et femmes, et des vivres. Nous emportâmes aussi le cadavre de Msiri, dont la tête fut immédiatement hissée au sommet d'un pieu élevé, bien en vue des habitants du pays. C'était là une leçon barbare, mais indispensable à donner à ceux qui, sans provocation de notre part, nous avaient attaqués.
«Le soir même, malgré tous les soins du docteur, Bodson mourut; nous l'enterrâmes le matin de très bonne Heure, afin de cacher le lieu de sa sépulture, et le lendemain, 21 décembre, car ces terribles événements s'étaient passés en quelques jours, nous nous mîmes en quête d'un emplacement plus facile encore à défendre que celui que nous occupions.
«Il était urgent de nous tenir prêts à repousser une attaque du grand chef Loukoukou, dont on nous annonçait le retour avec ses cinq mille guerriers.
«Nous trouvâmes ce refuge à
une demi?heure de marche, dans un village fortifié que ses habitants
avaient abandonné la veille, à la nouvelle de la mort de Msiri
et du pillage de Moémena, et notre premier soin, le choix de notre
nouveau campement bien arrêté, fut d'envoyer des courriers dans
toutes les directions, pour annoncer aux gens du pays que nous voulions la
paix, et que, leur cruel souverain étant supprimé, il n'y aurait
plus maintenant ni razzias, ni esclaves, ni dévastations. L'effet de
cette clémence se fit immédiatement sentir. L'aîné
des fils de Msiri, nommé Mounga Ouatou, «Qui jette des sorts
aux hommes», accourut faire sa soumission.
«C'était un grand et superbe noir d'une trentaine d'années,
à la physionomie ouverte et intelligente, et valant beaucoup mieux
que ne le faisait craindre le vilain nom qu'il tenait de son père.
Par politique, nous le nommâmes sultan, et il nous jura fidélité.
«Notre victoire était complète:
nous avions débarrassé le pays d'un despote sanguinaire; le
drapeau indépendant du Congo flottait sur un territoire d'où
jusqu'alors il avait été repoussé, et nous avions pour
allié le successeur même de celui que nous avions détrôné
et puni. Il ne nous restait plus? qu'à consolider notre pouvoir; en
attendant les ordres qui ne, pouvaient tarder à nous arriver d'Europe».
Reprenons maintenant notre rôle de narrateur, toujours à l’aide
des notes du marquis de Bonchamps.
IV
Le fort Bunkéia? La famine? Arrivée de la mission Bia. Départ pour le Mozambique? Le Nyassa? Karonga. ?La compagnie British Central Africa et le chef Makanzira? Mort du capitaine Stairs? De Chindé à Zanzibar? Conclusion.
Le lendemain même de l'arrivée de la caravane sur le nouvel emplacement choisi, les lignes du fortin qui allait l'abriter étaient tracées, et le jour suivant, tout le monde se mit à l’œuvre; mais les travaux marchèrent lentement. Les hommes étaient abattus par la fièvre, et les vivres commençaient à manquer. On ne trouvait rien à 20 milles à la ronde; les populations s'étaient enfuies. dans la brousse, et l'inondation causée par le débordement de la Loufira, affluent de la Loualaba, rendait inabordables les plaines situées en avant de Bunkéia et où le gibier abondait.
Il restait bien aux explorateurs quelques caisses de conserves, mais Stairs défendait qu'on y touchât, et moins d'une quinzaine plus tard il avait sous ses ordres plus de malades que d'individus valides.
Ce fut le marquis de Bonchamps qui ouvrit la série, il s'alita jusqu'au 3 janvier, puis ce fut le tour du capitaine et celui du docteur Moloney.
Néanmoins les terrassements ne furent pas interrompus un seul instant, et le 25 janvier les vainqueurs de Msiri étaient enfermés dans une véritable redoute, qu'ils baptisèrent «le fort Bunkéia». C'était un polygone allongé, défendu par une palissade de 5 mètres de hauteur, un talus de 2 mètres et un fossé de 1 m. 50 de profondeur sur 3 de largeur, et flanqué de trois tours assez élevées pour permettre de découvrir de leurs plates?formes tous les environs.
A l'intérieur de la redoute se trouvaient des baraquements pour quatre cents hommes et trois maisons pour les chefs de l'expédition. Ce travail surhumain avait été exécuté en moins d'un mois par de véritables squelettes. La famine régnait au camp. Chaque jour, huit à dix morts, que les survivants pouvaient à peine enterrer, tant était grande leur faiblesse. Stairs ne quittait plus sa tente; M. de Bonchamps et Robinson, le domestique, étaient seuls à peu près debout, mais si faibles qu'ils pouvaient à peine s'éloigner d'un kilomètre. En une semaine entière, notre compatriote tua deux pigeons. Les. engagés se. nourrissaient d'herbes, de pourpier sauvage, de fourmis blanches et de sauterelles, qui, parfois, comme une manne tombant du ciel, venaient s'abattre contre les palissades de l'enceinte. Cent indigènes succombèrent en moins d'un mois.
Cependant les courageux voyageurs tenaient bon, et comme leurs souffrances demeuraient ignorées, la pacification du pays s'accomplissait. Devant l'attitude si ferme de ceux qui les avaient débarrassés de leur tyran, les chefs venaient faire leur soumission. Ils étaient, il est vrai, peu en état de combattre, car leurs sujets mouraient de faim.
C'est dans cette situation terrible que les
explorateurs atteignirent le 28 Janvier; ils n'avaient plus que quelques jours
de vivres, et le désespoir commençait à s'emparer des
noirs, lorsque, ce 28 Janvier, un indigène venant du nord apporta à
M. de Bonchamps une lettre du capitaine Bia, parti depuis plusieurs mois du
Congo, où l'on était inquiet de l'expédition belge, et
envoyé pour lui prêter main?forte.
Le lendemain M. Bia arriva, ravitailla le camp et, après avoir constaté
que l'officier Anglais et ses héroïques auxiliaires avaient complètement
rempli leur mission, au prix des plus grands sacrifices, il engagea M. de
Bonchamps à conduire la caravane à la côte du Mozambique,
la plus facile à atteindre.
M. Stairs, dont l'état était fort grave, accepta cette solution, et le 5 février, après avoir remis le fort Bunkéia au capitaine Bia, qui était à la tête de 400 hommes bien armés, le marquis de Bonchamps prit le commandement de la troupe, réduite de près de moitié, et il se dirigea vers le nord du lac Moëro. Il emportait le capitaine étendu dans un hamac.
Le retour de ceux qui restaient de l'expédition du Katanga allait être encore plus pénible que la première partie de leur voyage.
La pluie tombait torrentielle et sans trêve; le pays entier ne formait en quelque sorte que des marécages, d'où les hommes sortaient dévorés par les sangsues, et lorsque la caravane, qui se traînait épuisée, râlante, laissant çà et là un mort nouveau, eut franchi une seconde fois la Loufira, M. de Bonchamps dut réduire la marche à deux ou trois heures par jour, dans la matinée seulement. Notre compatriote était parfois obligé de se faire porter lui?même, auprès de Stairs, que la fièvre né quittait pas. Le docteur Monoley et Robinson faisaient également peine à voir. Quant aux engagés, ils ne chantaient ni ne dansaient plus comme dans les haltes des premiers mois après leur départ de Zanzibar: ils s'accroupissaient hâves, décharnés, fumant et prisant, car au moins le tabac ne leur manquait pas, mais paraissant ne plus croire qu'ils reverraient la côte, et ne se relevant que par un effort surhumain pour se remettre en route.
C'est dans ces conditions que Stairs et ses compagnons arrivèrent, à la fin de mars, au nord du Moëro, où, toujours soucieux du but de l'expédition du Katanga, ils signèrent un traité d'alliance avec un des Chefs du pays, Monepto, qui s'empressa de faire flotter le drapeau de l'État du Congo sur son village.
Du Moëro, la troupe décimée se dirigea au nord?est, pour éviter les immenses marais impraticables et pestilentiels du sud de Maroungou, et elle traversa les plateaux de l'Itaoua, où le thermomètre descendait parfois à zéro pendant la nuit. Les villages y étaient rares et les populations à ce point craintives qu'il était difficile de se procurer des guides et les moindres vivres. Enfin, après d'inénarrables souffrances, la colonne atteignit, le 25 Avril, la pointe sud du lac Tanganyika.
Là, les voyageurs étaient sauvés, car il y existe deux établissements européens, celui de la London Missionnary Sociely, à Kyniamkolo, et celui de la Compagnie des Lacs africains, à Fort Abercorn.
Ces établissements font un grand commerce d'ivoire, et l'expédition s'y procura quelques provisions, mais à des prix véritablement odieux. Sans prendre en considération les épreuves que venaient de subir les explorateurs, la Compagnie des Lacs les exploita cyniquement. Ainsi ils durent payer 25 shillings seize livres de farine.
Le nouveau chef de la caravane? M. Stairs avait remis à M. Bonchamps la direction de la marche se hâta, on le comprend, de quitter un pays que les Anglais rendaient plus inhospitalier encore que les indigènes, et il descendit au sud?est.
Seize jours plus tard, après avoir franchi les 320 kilomètres qui séparent les deux grands lacs, il arrivait à un second poste de la Compagnie des Lacs africains, à Karonga, sur la rive nord?ouest du Nyassa, c'est?à?dire en contrée à peu près civilisée.
Il avait suivi une route relativement facile, à travers un pays fertile, boisé, bien arrosé, où les fauves abondent, mais se montrent rarement en plaine.
De Karonga, un petit steamer transporta M. de Bonchamps et tout son monde, 200 engagés sur 400, à l'autre extrémité du Nyassa, à Fort Johnson.
Le Nyassa, mieux connu, plus fréquemment visité que le Tanganyika, est à peu près de la même étendue. Ses côtes élevées, surtout dans la partie nord, sont d'origine volcanique. C'est là que se dressent les monts Livingstone, à 3 000 mètres d'altitude. Le lac est à 600 mètres au?dessus du niveau de la mer. Vers le sud, ses rives sont découpées, pittoresques, semées d'innombrables villages. Poissonneux, sillonné par les embarcations des indigènes, et des steamers, environné de montagnes, que séparent de fertiles vallées, le Nyassa ressemble absolument à un lac de la Suisse.
De nombreux établissements européens en occupent déjà les côtes nord?ouest et sud, mais à l'est règne MakaDzira, chef noir intelligent, courageux, bien armé, qui est en guerre avec la Central British A frica et lui a déjà infligé deux échecs sanglants.
A Fort Jobnson, toujours sur le même steamer, la caravane s'engagea dans le Chiré, et, quelques jours après, elle atteignit Matopé, poste anglais, à peu de distance de la frontière de Mozambique.
Depuis sa sortie du Nyassa jusqu'à Matopé, le Chiré est un beau fleuve, poissonneux, peuplé de crocodiles et d'hippopotames, et bordé d'immenses forêts et de castes marécages. Malheureusement son cours navigable cesse à ce dernier point; il y est interrompu par des bas?fonds, des récifs, de véritables montagnes de rochers. C'est la région des cataractes.
Là M. de Bonchamps dut reprendre la
voie de terre, mais il y existe une route si bien entretenue par les Anglais,
qu'il ne mit que trois jours pour faire les 150 kilomètres qui séparent
Matopé de Katunga. II passa par Mandala et Blantyre, deux villages
situés dans une campagne merveilleusement fertile, où l'on cultive
le coton, le tabac et un café qui est le plus haut coté sur
le marché de Londres.
A Katunga, le poste le plus important du pays, il rencontra M. Foa, un Français
en exploration dans le haut Zambèze, et il s'embarqua sur le vapeur
Lady Nyassa, qui descendait le Chiré jusqu'à son confluent.
C'est ainsi que, sans nouvelles épreuves, là colonne arriva
le 3 juin à Vicente, sur la rive gauche du Zambèze, en territoire
portugais, où Stairs, épuisé, fut emporté brusquement,
le 8 du même mois, par un accès de fièvre hématurie.
Des Européens de l'expédition
du Katanga, le marquis de Bonchamps restait seul, avec le docteur Moloney
et le domestique Robinson.
Les compagnons de l'infortuné officier anglais lui firent des funérailles
honorables, à la station de Chindé, à l'embouchure du
bras central du Zambeze, et notre compatriote affréta, au prix de 750
livres, un steamer de la Royal Mail Portugaise, qui le conduisit en huit jours
à Zanzibar.
Des quatre cents engagés dont s'était composée la caravane au départ, 189 seulement revoyaient la côte.
Quinze jours plus tard, M. de Bonchamps, le docteur Moloney et Robinson s'embarquèrent pour Marseille, où ils arrivèrent le 21 juillet 1892.
Cette dramatique excursion, qui a coûté la vie à deux braves officiers et à 210 hommes, et a nécessité des dépenses considérables, a?t?elle eu des résultats appréciables pour l'extension et l'affermissement de l'autorité de l'État Indépendant du Congo Belge.
M. de Bonchamps lui?même l'ignore. A son retour en Europe, il s'est hâté de se rendre à Bruxelles, où il a bien vu les administrateurs de la société de Katanga, ainsi que les hauts fonctionnaires du Congo, à qui il a rendu compte de la mission dont les événements l'avaient fait le chef in extremis et prédit le soulèvement actuel des indigènes contre les Européens, mais depuis il n'a entendu parler de rien ni de personne.
Ses services n'ont pas été récompensés à leur juste valeur; on lui a promis et même décerné une médaille d'honneur, mais il ne l'a pas encore reçue: si bien que le souvenir seul de tant d'épreuves lui restera de son héroïque expédition. Son regret est de n'avoir pas souffert ainsi pour la France, dont il s'est montré le digne fils au centre du continent noir.
RENE DE PONT-JEST
FFSA
Federation of the Free States of Africa
Contact
Secretary General
Mangovo Ngoyo
Email: [email protected]
www.africafederation.net